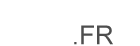Dans une réponse ministérielle récente (8 avril 2025), le ministère de la Justice a été amené à se positionner sur l’obligation qui serait faite aux psychologues de se défaire du secret professionnel en cas de révélation de violences conjugales en application de l’article 226.14 du Code pénal ici commenté et ce en application de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020.
Pour mémoire cet article délie le « médecin ou à tout autre professionnel de santé » du secret s’il « porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple si ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences ».
Nous validons la première partie de la réponse ministérielle en ce qu’elle rappelle qu’un psychologue n’est pas un médecin et qu’il n’est pas un professionnel de santé tel que défini par le code de la santé publique (aux articles L4111-1 et suivants du CSP, L4211-1 et suivants du CSP, et L4311-1 et suivants du CSP).
Nous validons le fait que la question est également simple si le psychologue est agent public et ce depuis la modification de l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique (ici présenté). Un psychologue appartenant à la fonction publique est tenu au secret professionnel dans le respect des dispositions susvisées du code pénal.
Là où nous sommes toujours aussi dubitatifs c’est sur l’idée qu’à « l'instar des psychologues agents publics, les psychologues libéraux sont tenus au secret professionnel, au sens de l'article 226-13 du code pénal. Cette disposition s'applique par conséquent aux psychologues de manière générale, la Cour de cassation considérant de façon constante que la nature même de leur activité faisant d'eux des « confidents nécessaires », ils doivent être soumis à cette obligation (Crim. 28 octobre 2008, no 08-80.828 ; Crim. 26 juin 2001, no 01-80.456). »
Examen des deux jurisprudences citées
Deux jurisprudences font elles le printemps ? Après les avoir lu à aucun endroit il n’est fait état de cette notion de « confident nécessaire ». Notion qui figure par exemple à l’article 2 du Code de déontologie des avocats, et réaffirmé récemment par la Cour de justice européenne.
Dans la plus récente des affaires citées (2008) le psychologue n’était pas en libéral (« un psychologue, Tony Y..., qui a fait part à sa supérieure hiérarchique, Catherine Z..., d'une mesure d'AEMO prise dans l'intérêt de ses enfants », information collectée dont il « a eu connaissance en 1998 par Mme A..., chef de service de l'AEMO, d'une décision du juge des enfants concernant Barbara X.. au cours d'une réunion ». On est bien loin de révélation confiée en libéral à un psychologue.
Dans l’autre affaire régulièrement il s’agissait d’une «psychologue scolaire Brigitte Z... à qui Dorothée Y... aurait révélé les actes à caractère sexuel dont elle avait été victime de la part d'un de ses professeurs Patrick X ». Là aussi bien loin de l’exercice en libéral.
Donc, pour nous, la question n’est pas tant la levée du secret professionnel du psychologue mais bien son assujettissement à cette obligation pénale dès lors qu’aucune disposition ne le soumet ni par profession, ni par mission.
Qu’aucun malentendu ne subsiste ici : nous aimerions pouvoir affirmer le contraire et proclamer que tout psychologue est soumis au secret professionnel. Au cœur de l’intime, de la confidence, de la vie privée, une telle exigence serait logique. Tout comme elle le serait pour un médiateur familial ou un mandataire à la protection des majeurs exerçant en libéral. Curieux paradoxe que de voir l’agent municipal de la voirie ou la femme de ménage de l’école maternelle soumis au secret –en leur qualité d’agent public- tout en n’imposant pas clairement de telles exigences pénales pour un psychologue en libéral.
Enfin, cette réponse ministérielle montre une fois de plus la nécessité de vérifier les sources sur lesquelles s’appuient ce type de productions. La citation d’un ou plusieurs arrêts de la Cour de cassation incite à prendre « pour argent comptant » ce qui est énoncé dans une réponse ministérielle, qui plus est lorsqu’elle provient du ministère de la Justice. Mais une telle réponse peut parfois contenir des erreurs et ainsi diffuser une analyse biaisée. Cette analyse biaisée n’est pas sans conséquence dommageables probables. Elle peut amener des psychologues en libéral à agir avec les marges de manœuvre qu’autorise le secret professionnel alors qu’ils n’y sont pas soumis (lors d’auditions dans le cadre d’une enquête judiciaire ou devant une situation de mineur en danger) pourrait les amener dans des situations risquées pénalement pour eux.