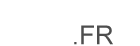De cette désormais célèbre affaire Betharram on ne connait aujourd’hui que l’écume et il faudra probablement des années pour mesurer définitivement son impact. Qui a subi quoi ? Qui a fait subir ? Qui savait quoi ? Qui a fait quoi ? Qui a signalé quoi ?
Le rapport parlementaire de juin 2025, largement médiatisé, ne pouvait nous laisser indifférents, en particulier dans son chapitre intitulé : « Secret médical, secret de la confession : des obstacles à lever ? ».
A cette question il est rapidement répondu que «différents types de secrets reconnus par la loi ou la jurisprudence sont susceptibles de faire obstacle à la dénonciation de violences commises contre des enfants ». Le problème se situerait donc probablement plus du côté des normes que des individus sensés les respecter.
En ce qui concerne les médecins le rapport pointe qu’effectivement, comme toute personne soumise au secret professionnel, ils ne peuvent être reconnus coupables des infractions prévues aux articles L. 434-1 et 434-3 du code pénal, qui instituent une obligation de signalement en cas de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger notamment en raison de son âge. Obligation dont le non-respect est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une peine d’amende pour les personnes non-soumises au secret professionnel.
Impunité totale ou secret absolu ? Pas tout à fait. Comme le note le rapport, deux exceptions sont prévues. Une de portée obligatoire : le secret médical ne saurait soustraire les médecins à l’obligation d’assistance obligatoire en cas de péril. Lorsqu’il est possible d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de l’enfant ou de porter assistance à un enfant en péril, l’obligation d’intervenir prévue à l’article 223-6 du code pénal est, elle, applicable aux médecins et plus généralement à tout un chacun. Il y aurait donc pour les rapporteurs un flou lié à la hiérarchie entre ces deux exceptions : « la règle posée à l’article 223-6 est juridiquement de même valeur que celle relative au secret professionnel figurant à l’article 226-13 et il n’est donc pas évident que l’une doive primer sur l’autre ». Nous ne partageons pas cette conclusion. Selon le principe fondamental du droit selon lequel les lois spéciales sont supérieures aux lois générales, la disposition sur le péril s’impose à celle générale relative au secret professionnel. Au demeurant, dans le doute le quantum des peines encourues dans ces deux hypothèses (un an de prison en cas de violation du secret d’un côté et 7 ans pour non-assistance à mineur en péril) nous semblent faire pencher vers l’obligation de signalement !
La 2eme exception de portée relative prévoit que les médecins ont la possibilité de procéder à un signalement ou une information préoccupante sans risquer d’être poursuivis pour « révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire ». L’article 226-14 du code pénal prévoit expressément que le secret professionnel n’est en effet pas applicable « 1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ».
En conclusion, et en opposition avec une idée aujourd’hui largement dominante que nous avons déjà critiquée, les rapporteurs ne proposent pas une levée absolue du secret professionnel. Selon eux, elle «pourrait avoir des effets contreproductifs si elle conduisait les patients à ne pas se confier de la même façon » et même conduire des « familles maltraitantes à ne plus emmener leur enfant chez le médecin, par crainte de faire l’objet d’un signalement ». A défaut les rapporteurs proposent de reprendre, en l’élargissant à toutes les violences commises contre des enfants, la recommandation n° 13 de la Ciivise qui appelait à « clarifier l’obligation de signalement par les médecins des enfants victimes de violences sexuelles ».
Même s’il nous semble que les textes sont clairs actons qu’ils puissent ne pas l’être surtout quand un professionnel médical est seul, dans l’émotion et l’urgence. A droit constant il est probable qu’une circulaire détaillée ou un guide pratique (avec des situations types) ne soit pas un luxe mais redescendront-t-ils au plus près des professionnels concernés ? Quelle que soit le support de cette clarification il ne pourra faire l’économie d’y associer l’Ordre des médecins qui a pu participer par un certain nombre de ses décisions d’une grande confusion en la matière.
Rappelons au demeurant que la loi de mars 2007 réformant la protection de l’enfance prévoit qu’un médecin référent protection de l’enfance puisse être l’interlocuteur des médecins face à des situations complexes. Dans nombre de départements ils n’ont pas été recrutés ou occupent cette fonction parmi tant d’autres.
Curieusement alors que le rapport insiste sur la nécessaire formation des personnels des établissements scolaires et des travailleurs sociaux en matière de violence sur enfants une telle exigence n’est pas posée quant aux professionnels médicaux.
Le 2eme axe de ce chapitre porte sur le secret de la confession aux « caractéristiques proches » du secret médical.
Le droit est clair. Le secret de la confession n’est qu’une forme de secret professionnel tel que défini à l’article 226-13 du code pénal. Il n’est ni inférieur, ni supérieur à ses autres formes (secret médical, secret de l’instruction, etc...). Et ce contrairement aux propos du président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulins-Beaufort, qui affirmait, en 2021 que « le secret de la confession s’impose à nous et s’imposera à nous. En cela, il est plus fort que les lois de la République ». Il s’appuie ce faisant sur le Code du droit canonique qui prévoit à son article 983-1 que « le secret sacrementel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit ». Pour l’intéressé « le sacrement du pardon est un moment spécial, lors duquel le pénitent est assuré que sa parole est adressée à Dieu et qu’elle n’aura donc pas de conséquences humaines », affirmant que le droit au secret reconnu aux confesseurs devait « être utilisé avec discernement ».
En conséquence les rapporteurs proposent « de changer la loi pour y préciser que les informations dont a connaissance un ministre du culte dans le cadre de l’exercice de celui-ci ne sont pas couvertes par le secret, au moins si elles concernent des faits de violences commis sur des mineurs de quinze ans ». Pour nous cette modification ne s’impose pas, les religieux relevant des mêmes dispositions précitées plus haut quant aux médecins ou plus généralement pour toute personne assujettie au secret. Dans tous les cas nous espérons que la recommandation 34 qui prévoit de «lever systématiquement le secret obtenu dans le cadre de la confession dès lors qu’il porte sur des faits de violences commis sur un mineur de moins de 15 ans, qu’ils soient en cours ou non » donnera lieu à un nécessaire débat. Sa rédaction (« systématiquement », toute violence sur mineur etc...) nous fait craindre de basculer d’un radicalisme à un autre.
Pour l'équipe de Secret.pro